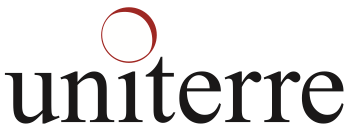Des nouvelles techniques génomiques, une loi spécifique en discussion, un moratoire qui arrive à termes en 2030, une initiative pour une régulation stricte et des militant.exs qui exigent plus de radicalité. Voici comment on pourrait résumer la situation sur le front des OGM, que nous avons essayé de retranscrire dans cet article.
Le moratoire de 2005 qui interdit l’utilisation de plantes et animaux génétiquement modifiés a expiré fin 2025 mais a d’ores et déjà été reconduit jusqu’en 20230. D’ici là, il faudra donc une nouvelle réglementation en la matière.
Nouvelles techniques OGM
Ces dernières années, de nouvelles techniques du génie génétique ont vu le jour. Celles-ci n’introduisent plus de gènes d’organismes étrangers dans le génome (p. ex ciseaux génétiques, CRISPR/Cas9). Les multinationales du génie génétique profitent de cette subtilité et mettent tout en œuvre pour que ces nouvelles technologies puissent être exemptes de la réglementation stricte des organismes génétiquement modifiés (OGM). Indépendamment de la question de savoir si des gènes étrangers sont intégrés ou non dans un organisme, les risques pour l’homme et l’environnement persistent. Le nombre croissant d‘études sur les effets non-désirés du génie génétique démontre clairement que ces nouvelles technologies ne sont pas si sûres que ça. Lors de l’apparition des premiers OGM, on nous promettait que cette technologie diminuerait massivement le besoin en produits phytosanitaires. Mais c’est bien le contraire qui s’est produit. Depuis, l’application de phytos sur le plan mondial a carrément explosé.
Des patentes et des licences empêchent les fermes de produire leurs propres semences. Aussi, il est important qu’à l’avenir, la sélection sans OGM soit protégée et non pas soumise à des patentes. En grande partie, les consommatrices et consommateurs continuent à refuser les OGM, tandis que la grande distribution ainsi que l’USP sont plutôt favorables aux nouvelles techniques du génie génétique. L’USP en espère des progrès plus rapides pour mieux affronter les défis du futur. Mais pour atteindre des buts impliquant plusieurs ou même une multitude de gènes (p.ex. résistance à la sécheresse), il faut – là aussi – beaucoup de patience, de temps et d’espoir jusqu’à l’obtention d’un résultat valable.
L’initiative pour des aliments sans OGM
Cette initiative est issue du contexte décrit ci-dessus.
- Elle veut garantir le libre choix des consommatrices et consommateurs par l’obligation de déclarer tout OGM et des produits qui en sont issus.
- Une évaluation stricte des risques de tout OGM est exigée, afin de protéger l’humain, l’animal et l’environnement.
- Conformément au principe de précaution, l’agriculture sans OGM doit rester possible et être protégée.
- Les frais d’une éventuelle coexistence seront mis à charge des protagonistes d’OGM, de même que toute responsabilité en cas de dommages.
- La Confédération doit activement soutenir la recherche, la sélection et la production sans OGM, et la sélection sans OGM ne doit pas être entravée (par des patentes p. ex.)
L’initiative ne veut donc pas interdire les OGM. (Ceci est un choix stratégique après de longues discussions !). Mais des règles strictes doivent permettre et garantir une agriculture sans OGM ainsi que le libre choix des consommatrices et consommateurs.
Réaction de la politique
Le 4 septembre 2024, le lendemain du lancement de l’initiative donc, le Conseil fédéral annonce pour décembre 2024 la consultation d’une loi spéciale sur les nouvelles techniques du génie génétique. Bien évidemment, le conseiller fédéral Albert Rösti sert le lobby de l’agrochimie et veut à tout prix ouvrir la porte aux nouvelles techniques du génie génétique.
Pour signer (et faire signer) l’initiative, c’est par ici : https://www.protection-des-aliments.ch/
Des événements de récolte de signatures, n’hésitez pas à vous inscrire : https://act.protection-des-aliments.ch/evenements
De plus, dans le but d’alimenter le débat démocratique, nous reproduisons ici une prise de position critique de la ferme collective du Joran et membre de notre organisation.
OGM, une capitulation qui ne dit pas son nom ?
En tant que ferme pratiquant l’agriculture paysanne et participant à l’organisation Uniterre, nous sommes sollicité·es pour faire signer l’initiative « Pour des aliments sans OGM (Initiative pour la protection des aliments). » Après avoir découvert le texte, nous l’avons trouvé trop problématique pour distribuer les feuilles de signatures dans nos paniers. Ensuite nous avons lancé une discussion au sein du comité d’Uniterre, car Uniterre fait partie de la coalition qui porte l’initiative. Notre intention avec ce texte n’est pas de saboter cette initiative, mais de faire entendre une autre voix.
Pourquoi cette initiative a été faite ?
Contexte : le moratoire sur la culture et la commercialisation des OGM (définir), en vigueur en Suisse depuis 2005 et reconduit tous les quatre ans, devait prendre fin en 2025. Il vient maintenant d’être prolongé de deux ans, jusqu’en 2027, afin que le parlement puisse se prononcer sur la « loi spéciale » sur les OGM prévue par le Conseil fédéral. Mais les organisations opposées à cette technologie, fédérées au sein de l’ASGG (Alliance suisse pour une agriculture sans génie génétique, anciennement StopOGM), viennent de lancer une initiative populaire fédérale pour inscrire dans la constitution des règles sur la définition, les autorisations et l’étiquetage des OGM, ainsi que sur la coexistence entre cultures avec ou sans OGM.
Il nous semble important de noter que cette initiative arrive dans un contexte politiquement difficile. Nous n’avons en effet pas oublié l’apparition en 2021 du lobby Sorten für Morgen / Variétés de demain, qui était parvenu à rallier les associations faîtières agricoles ainsi que Coop, Migros et Fenaco à la cause des « nouvelles techniques de sélection », entendez par là les nouveaux OGM. Nul doute que cela a influé sur le rapport de forces sur cette question dans la politique suisse, notamment en ouvrant une brèche dans le positionnement de l’USP et de la grande distribution, qui jusque là s’affichaient contre les OGM « parce que les consommateurs n’en voulaient pas. ». Cependant ça ne veut pas dire que l’opinion de la population a changé.
Pourquoi cette initiative est molle et pleine de compromis ?
Selon les initiant·es, si rien n’est fait les nouveaux OGM ne vont pas être considérés comme des OGM. C’est effectivement une bataille en cours depuis une dizaine d’années, depuis que l’invention de la technologie CRISPR-Cas9 a motivé une offensive des lobbies industriels et scientifiques pour contourner les lois qui freinent l’usage des OGM. C’est selon nous le seul bon point du texte : selon le 1er article, toute plante modifiée génétiquement, même avec les nouvelles méthodes, doit être considérée comme un OGM.
Cependant, l’article 4 stipule que tous les aliments contenant des OGM doivent être étiquetés. Ceci s’inscrit dans un scenario où il y en aura de fait sur les étalages. De même, l’article 5, qui met les coûts de la coexistence dans les champs à la charge de celleux qui les mettent en circulation, assume qu’il y aura des contaminations. En effet, lesdits coûts seront principalement les frais juridiques qui nous permettront d’attaquer nos voisin·es paysan·nes qui auront contaminé nos champs. Bonjour l’ambiance !
Enfin, l’article 6 limite la brevetabilité du vivant aux plantes et animaux issus du génie génétique, pour contrer l’offensive massive des multinationales comme Syngenta qui profitent de la brèche ouverte par les OGM pour breveter des êtres vivants, certaines de leurs propriétés ou de leurs séquences génétiques, au prétexte qu’elles les ont « découvertes ». Ce faisant, l’article 6 reconnaît les brevets sur les variétés génétiquement modifiées comme légitimes !
L’expérience du marché des fruits montre que la problématique des brevets porte au-delà de la question du monopole et des royalties. Depuis la mise sur le marché des pommes « Club » brevetées, les normes de calibrage et de coloration sont devenues beaucoup plus strictes, et celleux qui cultivent des variétés non brevetées peinent à écouler leurs produits avec cette élévation des normes dans la grande distribution. Cette pression du marché peut s’ajouter à la pression étatique, avec des paiements directs qui peuvent facilement encourager à prendre certaines variétés de céréales, jugées moins risquées au niveau sanitaire ou plus productives, plutôt que d’autres qui ne bénéficient pas d’un lobbying aussi appuyé que les nouveaux OGM. Demain, les paysan·nes contraint·es à adopter les OGM pour survivre économiquement ?
Pourquoi nous n’allons pas nous impliquer dans cette campagne de signatures ?
Le contenu du texte pose selon nous un problème stratégique, puisqu’en mettant des conditions à l’arrivée des OGM, il accepte que cette arrivée est inéluctable. Toutes les organisations censées être fermement opposées aux OGM se rallient à cette initiative, sans qu’il y ait une alternative portant un refus des OGM sans compromis. On dirait un contre-projet du parlement, pas une initiative de l’opposition !
Pire : les compromis ne sont pas assumés comme tels dans la communication, à commencer par le titre de l’initiative : « Pour des aliments sans OGM ». Il est indispensable de lever cette ambiguïté : se bat-on pour que tous les aliments soient sans OGM, ou pour qu’il reste certains aliments sans OGM ? Et à supposer que ça reste possible, qui aura accès à ces aliments privilégiés alors que les aliments contenant des OGM seront évidemment moins chers ?
Selon les initiant·es, ce serait la bonne manière de contrer la puissance des lobbyistes. Il n’y aurait aucune chance de simplement interdire les OGM, sans que ce soit expliqué pourquoi. Résultat, on refuse aux votant·es la possibilité de clairement rejeter les OGM, tout en leur vendant l’impression qu’iels le font. Par un calcul politique qui nous échappe, l’on ne veut pas proposer à la population un texte qui n’obtiendrait pas une majorité au parlement, l’on préfère parier sur le fait que les contraintes imposées par l’initiative rendront l’agriculture avec OGM trop compliquée et trop coûteuse, bien qu’autorisée.
Nous n’avons aucune confiance dans les institutions fédérales qui seront chargées des autorisations et de l’application des lois. Il est évident que l’industrie agro-alimentaire mettra le pied dans la porte et se saisira de cette opportunité pour obtenir l’autorisation de certaines variétés. Si l’OFAG estime qu’il faut les promouvoir et qu’il semble y avoir des avantages économiques, que ce soit pour les exploitations les plus industrialisées ou pour des exploitations à la limite de la survie, ces OGM seront cultivés. Ensuite la porte sera ouverte à un élargissement de l’usage des OGM plus tard, à la faveur de telle ou telle crise, puis à leur normalisation…
Nous aimerions soulever la problématique d’une organisation faîtière à laquelle on délègue la gestion d’un problème, sans qu’on exerce vraiment un regard sur ce qu’elle fait. Ce n’est pas la première fois qu’on ne comprend pas comment l’ASGG définit sa stratégie. En 2008, un communiqué de presse de StopOGM affirmait : « Nous désirons la création de régions avec OGM au sein d’une Suisse qui forme une grand « Région sans OGM » ». En 2014, on pouvait lire Luigi D’Andrea, secrétaire de StopOGM, dans le magazine Environnement : « StopOGM mettra sons grain de sel pour que la coexistence proposée soit adaptée à la réalité suisse ». Aujourd’hui, rebelote avec cette initiative. Nous n’arrivons pas à croire que la majorité des membres de l’ASGG se reconnaisse dans ces prises de position. Nous savons qu’il est difficile d’être sur tous les fronts, et qu’il est commode de déléguer le travail politique à d’autres. Mais force est de constater que si on ne fait pas au moins un travail de retour et de discussion critique lorsqu’on n’est pas d’accord, on se retrouve à servir de caution pour des politiques qui ne sont pas les nôtres. Nous trouvons que l’initiative n’est pas cohérente, qu’elle propose de cogérer un problème au lieu de s’y opposer. Il est possible de s’engager sans faire de compromis, sans trahir ses valeurs, plutôt que de capituler d’avance.
La ferme collective du Joran